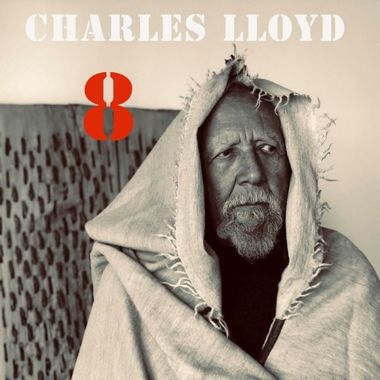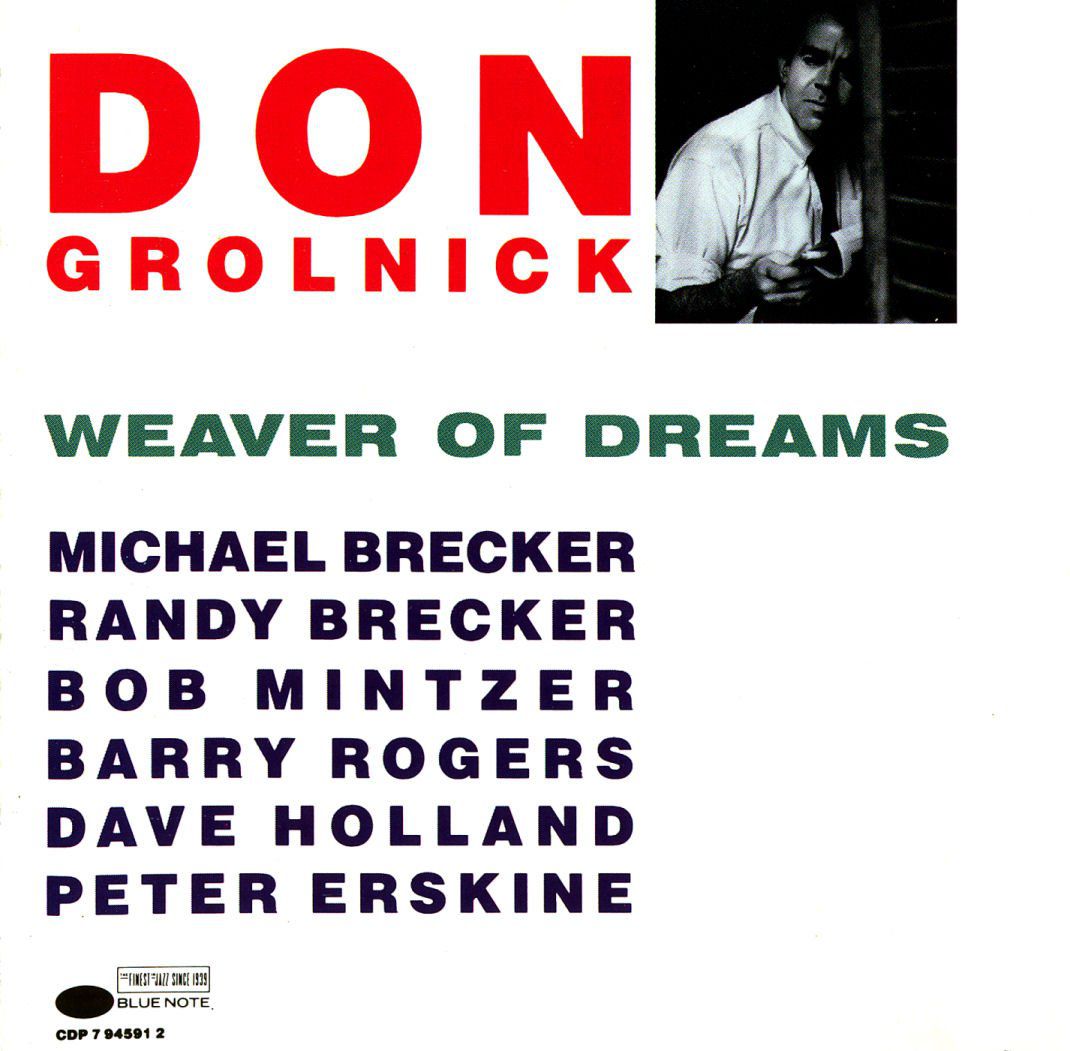Cinq nouvelles chroniques de disques édités cet automne lorsque les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Coproducteur et pianiste du Quint5t, un all star qui s’est produit dans l’hexagone en octobre 2019 et dont l’album mérite mes éloges, Marc Copland a depuis enregistré un opus en solo consacré au regretté guitariste John Abercrombie dont la sortie française est prévue l’année prochaine. Sous la plume de Frédéric Goaty, Jazz Magazine n’a pas attendu 2021 pour en publier un compte rendu dans son numéro de décembre. Le mien attendra qu’il paraisse. Le “Budapest Concert” de Keith Jarrett est par contre déjà disponible à la vente. Enregistré le 3 juillet 2016, c’est l’un des derniers concerts en solo du pianiste, le côté gauche de son corps aujourd’hui paralysé après deux AVC. Le 15 février 2017, peu après l’élection de Donald Trump, Jarrett donnait une ultime prestation au Carnegie Hall de New York et fustigeait la politique du nouveau président. Joué en rappel, Autumn Nocturne est le dernier morceau qu’il interpréta sur scène.
Keith JARRETT : “Budapest Concert” (ECM / Universal)
/image%2F0558410%2F20201127%2Fob_62ea7e_keith-jarrett-budapest-concert-cov.jpeg)
Le 3 juillet 2016, sur la scène du Béla Bartók Concert Hall de Budapest, Keith Jarrett improvise une suite musicale, douze parties indépendantes de longueur raisonnable qu’il fait suivre par deux standards. Un flot de notes abstraites et dissonantes envahit la première, la plus vaste, une cathédrale sonore qu’il construit pierre par pierre sans craindre le vide, sans convoquer de mélodie. La tempête s’apaise par de sombres accords (Part II). Les doigts courent à nouveau sur le clavier sans exposer de thème, Jarrett le derviche faisant tourner les notes ondulantes d’un ostinato incantatoire tout en contrôlant parfaitement leur dynamique, leur puissance orchestrale. Les pièces lyriques du second de ces deux disques séduisent toutefois bien davantage. Le pianiste virtuose devient romantique et met son merveilleux toucher au service des mélodies qu’il invente. De forme chorale, les cinquième et onzième parties de son concert bénéficient d’un jeu sobre et lumineux. Jarrett s’abandonne pour faire pleinement chanter la mélodie de la septième dans un majestueux crescendo de notes chatoyantes. Ces dernières tintinnabulent dans la huitième, procédé utilisé à Rio en 2011 (Part II) et à Paris en 2008 (Part III) dont nous possédons les enregistrements. Quant aux deux rappels, It’s a Lonesome Old Town et Answer Me, My Love, ils semblent sortir d’un rêve et éblouissent davantage encore qu’à Munich où, quelques jours plus tard, le pianiste en donna des versions que l’on croyait indépassables.
Daniel HUMAIR : “Drum Thing” (Frémeaux & Associés)
/image%2F0558410%2F20201127%2Fob_4728f6_daniel-humair-drum-thing-cover.jpg)
Il y a trente ans, Patrick Frémeaux éditait pour sa galerie un album de six lithographies de Daniel Humair intitulé “Scratch, Bop and Paper”, Patrick entendant « dans les traits de l’abstraction narrative de la peinture de Daniel les fondamentales de ses baguettes sur les peaux, et dans ses aplats les harmoniques parfois longues de ses cymbales ». Avec Vincent Lê Quang aux saxophones ténor et soprano et Stéphane Kerecki à la contrebasse, le batteur a formé le trio Modern Art, pour improviser une musique aventureuse et ouverte, sans piano pour une plus grande liberté harmonique, une prise de risque illimitée. Composée par les musiciens de l’orchestre auquel se joint Yoann Loustalot au bugle, encadrée par un prologue et un épilogue, la musique qui rassemble trois Drum Thing(s) et cinq Interlude(s) conserve un aspect brut, primitif, la valorisation des timbres des instruments la rendant fortement expressive. Stéphane fait puissamment chanter les cordes de sa contrebasse. Sa sonorité ample se marie idéalement aux tambours de Daniel qui colore l’espace sonore, peaux, métal et bois la teintant de vibrations. Souple et ouvert, son drumming favorise l’interaction, le jeu collectif au sein duquel les deux souffleurs inventent et dialoguent, esquissent des pas de danse, une émouvante version de Send in the Clowns de Stephen Sondheim refermant un album dont je conseille vivement l’écoute.
Diego IMBERT / Alain JEAN-MARIE : “Interplay - The Music of Bill Evans”
(Trebim Music / L’autre distribution)
/image%2F0558410%2F20201127%2Fob_6c3cb9_diego-imbert-alain-jean-marie-interp.jpg)
Admirateur du pianiste Bill Evans, de ses albums en duo avec Eddie Gomez, “Intuition” (1975) et “Montreux III”, un concert donné la même année au Festival de Jazz de Montreux, Diego Imbert n’a jamais oublié le stage qu’il fit avec Gomez à Capbreton à la fin des années 90. Reprendre les morceaux que jouait Evans, ses compositions sans chercher à les copier, à imiter le duo originel, c’est ce qu’il proposa à Alain Jean-Marie qui hésita avant d’accepter l’aventure, le bassiste l’« encourageant à ne surtout pas chercher à jouer comme Bill, mais à revisiter son répertoire à sa manière ». Deux instruments heureux de s’épauler en proposent ainsi une relecture intimiste non dénuée de mélancolie. Assurant l’assise rythmique de l’album, la contrebasse sobre et lyrique de Diego répond aux choix mélodiques d’Alain qui expose sobrement les thèmes et les harmonise par ses voicings, ces accords qu’il plaque fréquemment et dont il modifie l’ordre des notes pour en changer les couleurs. Leurs sonorités riches et panachées qui ont séduit les nombreuses chanteuses qu’il a accompagnées habillent ici Nardis, Very Early, Blue in Green, Waltz for Debby et d’autres thèmes moins célèbres que jouait Bill Evans. Loin d’exhiber leur technique, d’allonger inutilement les versions qu’ils en donnent, les deux hommes les abordent avec simplicité, ne s’éloignent jamais des mélodies qu’ils mettent en valeur, la tendresse qu’ils leur portent les rendant très appréciables.
QUINT5T (InnerVoiceJazz / L’autre distribution)
/image%2F0558410%2F20201127%2Fob_ca3304_quint5t-cover.jpeg)
Cinq grands musiciens (six avec Ralph Alessi présent sur deux plages) sont ici rassemblés autour du piano de Marc Copland, coproducteur de cet album qui paraît sur son propre label. Drew Gress (contrebasse) et Joey Baron (batterie) assurent la rythmique de ses derniers disques. Marc a souvent joué avec David Liebman, “Bookends”, un album en duo de 2002, témoignant de leur complicité. Avec Randy Brecker, Marc enregistra deux ans plus tard “Both/And” pour le label Nagel Heyer. Si leur réunion en studio après une tournée européenne n’est donc pas surprenante, la musique, très variée, étonne néanmoins. Marc excepté, tous ont apporté des compositions, la musique chaloupée d’un thème que Duke Ellington écrivit en 1931, Mystery Song, introduisant le disque. Ornette Coleman aurait pu signer Off a Bird, un thème très simple de Liebman qui occasionne un dialogue plein d’humour entre les deux souffleurs. Le saxophoniste l’interprète au soprano bien que jouant surtout du ténor dans l’album. Le bugle de Randy Brecker donne de la douceur à Moontide et à Pocketful of Change, une ballade dont il cisèle les notes évanescentes. Drew Gress rend épaisses ses notes rondes et puissantes. Un piano rêveur les accompagne dans une reprise de Broken Time. Marc embellit Moontide et Figment par les couleurs de ses notes cristallines et tintinnabulantes. Leurs cascades ornementent Broken Time, morceau au tempo relevé, prétexte à une succession de chorus flamboyants.
Glenn ZALESKI “The Question” (Sunnyside / Socadisc)
/image%2F0558410%2F20201128%2Fob_506f0c_glenn-zaleski-the-question-cover.jpeg)
Installé à Brooklyn et originaire de Boylston (Massachussetts) Glenn Zaleski fait partie des talents émergeants que l’Amérique du jazz révèle à chaque génération. Influencé par le Bill Evans de “Everybody Digs Bill Evans” et de “Portrait in Jazz”, le pianiste reste attaché à la grammaire et au vocabulaire du jazz dont il joue le répertoire. Après deux enregistrements en trio pour Sunnyside, il publie aujourd'hui un disque largement consacré à ses propres compositions et presque entièrement en quintette avec des musiciens qu’il connaît bien. Lucas Pino qui joue du saxophone ténor est l’un de ses plus anciens amis. Il fréquente le bassiste Desmond White depuis ses années d’université et le batteur Allan Mednard a souvent été le gardien du tempo de ses concerts. Glenn retrouve aussi Adam O’Farrill dont la trompette contribue beaucoup à la réussite de cet album, ses interventions dans Backstep et Strange Meadow Lark de Dave Brubeck étant particulièrement convaincantes. Dans “Fellowship”, Glenn reprend déjà un thème de ce dernier. Il a joué avec lui en 2006 au Monterey Jazz Festival et le Brubeck Institute Fellowship de Stockton (Californie) au sein duquel il a étudié reste son alma mater. Écrit pour un nonnette, trois saxophones et un trombone y mêlant leurs timbres, le polyphonique Subterfuge nous fait découvrir le talent d’arrangeur du pianiste dont les notes fluides redoublent d’élégance dans BK Bossa Nova, morceau magnifié par la guitare de Yotam Silberstein.
Crédits photos : Budapest © Martin Hangen – Quint5t (Randy Brecker, Joey Baron, Marc Copland, David Liebman, Drew Gress © TJ Krebs.

/image%2F0558410%2F20201130%2Fob_c5060d_budapest-martin-hangen.jpg)
/image%2F0558410%2F20201127%2Fob_647ad8_quint5t-tj-krebs.jpg)


/image%2F0558410%2F20201124%2Fob_4db26c_pierre-de-bethmann-trio-gildas-bocl.jpg)
/image%2F0558410%2F20201124%2Fob_286fa2_pierre-de-bethmann-essais-vol-4-c.jpg)
/image%2F0558410%2F20201124%2Fob_5abad0_pascale-berthelot-saison-secre-te.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201124%2Fob_622f97_thomas-fonnesbak-justin-kauflin-s.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201125%2Fob_bff049_tim-garland-refocus-cover.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201124%2Fob_4e14c4_adam-kolker-lost-cover.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201111%2Fob_0aac62_melody-gardot-laurence-laborie-la.jpg)
/image%2F0558410%2F20201111%2Fob_5886b0_melody-gardot-sunset-in-the-blue-c.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201111%2Fob_55b43b_melody-gardot-laurence-laborie-a.jpg)
/image%2F0558410%2F20201111%2Fob_002949_larry-klein-david-crotty-patrick.png)
/image%2F0558410%2F20201112%2Fob_75a44f_melody-gardot-photo-x-d-r.jpg)
/image%2F0558410%2F20201108%2Fob_1e5dad_thelonious-monk-larry-fink.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201108%2Fob_78a0af_underground-thelonious-monk.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201108%2Fob_7822b5_monk-palo-alto-concert-original-po.jpg)
/image%2F0558410%2F20201108%2Fob_ab4b12_monk-gales-lee-tanner-2.jpg)
/image%2F0558410%2F20201108%2Fob_9f5515_monk-palo-alto-cover.jpg)
/image%2F0558410%2F20201108%2Fob_e0f495_thelonious-monk-charlie-rouse-ver.jpg)
/image%2F0558410%2F20201108%2Fob_0b6a2c_thelonious-monk-jim-marshall.jpg)
/image%2F0558410%2F20201022%2Fob_40c321_martial-solal-dave-liebman-jean-b.jpg)
/image%2F0558410%2F20201022%2Fob_c8cfd5_martial-solal-dave-liebman-masters.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201022%2Fob_6e1253_bill-frisell-valentine-cover.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201022%2Fob_7bd6bf_ferruccio-spinetti-giovanni-ceccarel.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201022%2Fob_8e13b2_dominik-wania-lonely-shadows-cover.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201025%2Fob_f9825b_michael-wollny-jo-rg-steinmetz-a.jpg)
/image%2F0558410%2F20201025%2Fob_03a13e_michael-wollny-mondenkind-cover.jpg)
/image%2F0558410%2F20201007%2Fob_479718_andy-emler-christophe-charpenel.jpg)
/image%2F0558410%2F20201007%2Fob_2d8ec6_andy-emler-no-solo-cover.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_65bfab_humair-blaser-ka-nzig-1291-cover.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201007%2Fob_2d7e90_david-linx-skin-in-the-game-cover.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201007%2Fob_793703_raphae-l-pannier-quartet-faune-co.jpg)
/image%2F0558410%2F20201007%2Fob_2a8d5a_misja-fitzgerald-michel-franck-torti.jpg)
/image%2F0558410%2F20201007%2Fob_fbbc14_franck-tortiller-misja-fitzgerald-mi.jpg)