/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_8374d4_mickey-one-affiche.jpeg)
“Mickey One” : un film à part d’Arthur Penn
Intéressé par la « Nouvelle Vague » française et les réalisateurs italiens Federico Fellini et Michelangelo Antonioni, Arthur Penn rêvait depuis longtemps de réaliser un film « européen ». Les succès de “The Left-Handed Gun” (“Le Gaucher”) et de “The Miracle Worker” (“Miracle en Alabama”) lui permirent d’obtenir carte blanche de la Columbia pour le tourner avec un budget limité. Warren Beatty auquel Elia Kazan avait confié le rôle de Bud Stamper dans “Splendor in the Grass” (“La Fièvre dans le sang”) tient celui de Mickey One. L’acteur n’aimait pas le scénario mais fit confiance à un réalisateur avec lequel il voulait travailler.
Un artiste de cabaret de Détroit se croit piégé par une mystérieuse organisation. Il prend peur, détruit ses papiers, s’enfuit à Chicago, change d’identité et de travail, et devient Mickey One. Sa rencontre avec Jenny (Alexandra Stewart), jeune femme habitant son immeuble lui redonne la confiance qui va lui permettre de retrouver la scène bien que son désordre mental ne semble pas avoir complètement disparu.
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_a6a1e0_alexandra-stewart-warren-beatty-mi.jpg)
Sorti sur les écrans en 1965, “Mickey One” dérouta le public américain par le manque de clarté de sa narration. On ne sait ni par qui, ni pourquoi Mickey se sent persécuté. Jeune acteur, Warren Beatty est d’ailleurs peu convaincant dans le rôle. Pour Arthur Penn, la paranoïa de Mickey, « coupable de ne pas être innocent », est une allégorie du maccarthysme mais le film n’en donne pas la clef. On y croise des personnages étranges en des lieux improbables. Celui de l’artiste muet interprété par l’acteur japonais Kamatari Fujiwara qui tourna dans de nombreuses œuvres d’Akira Kurosawa est l’un des plus étonnants. Le film est davantage apprécié aujourd’hui, surtout en Europe. David Lynch nous a depuis habitué à des scénarios tout aussi obscurs qu’il vaut mieux ne pas chercher à comprendre.
/image%2F0558410%2F20201010%2Fob_ead81a_stan-getz-eddie-sauter.jpg)
L’un des points forts du film est son ambiance de film noir particulièrement bien rendue par une superbe photo en noir et blanc de Ghislain Cloquet, le chef-opérateur d’Alain Resnais et de Robert Bresson. La musique y tient aussi une place importante. Arthur Penn la confia à Eddie Sauter qui avait déjà travaillé pour lui. Ce dernier lui parla de Stan Getz pour lequel il avait composé “Focus”, l’un des grands albums du saxophoniste. Penn l’admirait et donna son accord pour qu’il participe au projet. Sauter et Getz visionnèrent de nombreuses fois les rushes sur une moviola et enregistrèrent la musique à New York avec un grand orchestre en août 1965*. De nombreuses répétitions et des journées de studio supplémentaires firent exploser le budget.
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_a0503b_donna-michelle-mickey-one.jpg)
Improviser sur la musique de “Mickey One” constitua pour Stan Getz un véritable défi, le plus dur de sa carrière compte tenu de la complexité de la partition et ce qu’il devait exprimer. Alter-ego de Mickey, son saxophone traduit ses états d’âme : sa résignation, sa tendresse pour Jenny, mais surtout sa peur et ses angoisses. Pour y parvenir, Getz dut s’investir dans la musique et donner le meilleur de lui-même. Il en fut très satisfait, la trouvant même plus réussie que celle de “Focus”. Éditée en 1965 sur le label MGM, “Stan Getz Plays Music from the Soundtrack of Mickey One” fait entendre la musique avant qu’elle ne soit coupée au montage. Elle est donc beaucoup plus complète que celle du film qui n’en présente que des extraits**. Seul le générique, l’éblouissant Once Upon a Time, n’a pas été tronqué. Ce dernier est d’ailleurs d’un grand raffinement esthétique. Playmate de l’année 1964, Donna Michelle, la ravissante jeune femme qui s’y promène, y contribue beaucoup.
/image%2F0558410%2F20201010%2Fob_928dae_stan-getz-mickey-one-lp.jpeg)
*Outre Stan Getz (saxophone ténor), l’orchestre (57 musiciens) comprend Clark Terry (trompette et bugle), Roger Kellaway (piano), Barry Galbraith (guitare), Richard Davis (contrebasse) et Mel Lewis.
**Sa réédition en CD en 1998 (Verve) contient ces extraits séquencés et son livret les propos d’Arthur Penn sur Getz précédemment cités.
Bullitt : un classique
/image%2F0558410%2F20201010%2Fob_08ec79_bullitt-affiche-film.jpeg)
Réalisé en 1968 par Peter Yates, “Bullitt”* est aujourd’hui un classique du film policier sur lequel il eut une grande influence. Steve McQueen qui avait précédemment tourné dans “The Thomas Crown Affair” (“L’Affaire Thomas Crown”) y incarne Frank Bullitt, un lieutenant de police intègre, rebelle à sa hiérarchie dans la recherche de la vérité. Sa poursuite de voitures dans les rues de San Francisco, McQueen en pilote accompli conduisant lui-même sa Ford Mustang, et la course finale sur les pistes de l’aéroport, l’acteur courant lui-même entre les avions qui décollent, sont célèbres. Michael Mann se souviendra de cette dernière scène lors du tournage de “Heat” quelques années plus tard. Quant à la course-poursuite en voiture, elle en inspira bien d’autres, à commencer par celle de “French Connection” de William Friedkin, un film également produit par Philip d’Antoni.
*Écrit par Harry Kleiner et Alan Trustman, le scénario est l'adaptation d'un roman de Robert L Pike (pseudonyme de Robert L. Fish), “Mute Witness” traduit dans la Série Noire sous le titre “Un Silence de mort”.
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_7c946c_lalo-schifrin.jpg)
Lalo Schifrin fut chargé de la musique. Ancien pianiste de Dizzy Gillespie*, Schifrin qui avait été staff arranger pour le label Verve et compositeur pour la MGM avait poursuivi une fructueuse carrière de compositeur de musiques de films. Avec “Dirty Harry” (“L’Inspecteur Harry”) et “Mission : Impossible”, celle de “Bullitt” est l’une de ses grandes réussites. Très présente dans le générique, la guitare d’Howard Roberts traduit bien l’atmosphère qui règne alors à San Francisco. La ville a vu naître le Flower Power un an plus tôt et le jazz en subit l’influence. Celui que Schifrin place dans sa partition possède ainsi des couleurs chatoyantes. Confié à un trombone, The Aftermath of Love séduit par ses timbres, flûtes et cordes y faisant bon ménage, et dans l’énergique On the Way to San Mateo les chorus de flûte et de guitare sont ponctués par les impressionnants tutti des cuivres.
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_cd6443_jacqueline-bisset-steve-mcqueen-bu.jpg)
Construit sur les simples accords d’un blues, mais complexe dans sa texture et son maillage de timbres, Shifting Gears et ses glissando de cuivres et de cordes qui se place juste avant la course des deux voitures, lorsque dans ces dernières les tueurs et Steve McQueen jouent au chat et à la souris, est également très réussi. « Contrairement à Peter Yates, je ne voulais pas de musique pendant la poursuite. Émettant des bruits différents, le moteur de la Dodge et celui de la Ford Mustang rendaient la scène suffisamment réaliste**. » C’est également dans un vrai club de jazz de San Francisco que se rendent Steve McQueen et Jacqueline Bisset. « Un groupe s’y produisait avec une flûtiste mais l’acoustique était si mauvaise que joué par Bud Shank (flûte), Howard Roberts (guitare) et Ray Brown (contrebasse), une de mes compositions, (A Song for Cathy), remplace le morceau initial ».
*Dizzy le rencontra en 1956 lors d’une tournée en Argentine. Pour le trompettiste, Lalo Schifrin (né à Buenos aires en 1932) écrivit “Gillespiana”.
**Entretien avec Lalo Schifrin contenu dans le livret de “Bullitt, Music from the Motion Picture” (Warner Bros), CD édité en 2001.
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_72663a_bullitt-b-o-lalo-schifrin.jpeg)
Réédité en CD en 2001 par la Warner, la musique de l’album n’est pas tout à fait celle du film. À la demande du producteur Jimmy Hilliard qui souhaitait donner au disque un aspect plus pop, d’autres prises furent enregistrées à Hollywood (Western Recorders) les 6 et 7 décembre 1968. Si des rythmes et des couleurs propres à l’époque habillent une partition de jazz élégante qui traverse le temps, on peut lui préférer l’enregistrement plus moderne et percutant qu’en a donné plus de trente ans plus tard, en avril 2000 dans ses studios de Cologne, le WDR Big Band.
/image%2F0558410%2F20201010%2Fob_ea6f50_lalo-schifrin-bullitt-music-recreat.jpeg)
Dans “Bullitt, Music Recreated from and Inspired by the Motion Picture” (Aleph Records/Warner), la formation placée sous la direction de Lalo Schifrin reprend les arrangements du disque, mais interprète aussi ceux que le compositeur destinait au film. On y découvre également certains morceaux supprimés au montage et un arrangement pour guitare du thème principal.
“Bullitt” (Bande-annonce) :
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_3d7b26_alfie-affiche-hauteur-2.jpg)
Alfie : un film dérangeant
Adapté d’une pièce de théâtre que son auteur, Bill Naughton, transforma en scénario, et réalisé par Lewis Gilbert, réalisateur anglais auquel on doit quelques James Bond (“You Only Live Twice”), “Alfie” (“Alfie le dragueur”) conserve une réputation sulfureuse et ferait probablement scandale s’il était tourné aujourd’hui. Le Prix Spécial du Jury qu’il obtint au Festival de Cannes l’année de sa sortie en 1966 n’empêcha pas le film de se mettre à dos une partie de la critique. Plusieurs acteurs parmi lesquels Richard Harris et Terence Stamp refusèrent le rôle. Michael Caine l’accepta, portant le film sur ses épaules.
/image%2F0558410%2F20201011%2Fob_4b28c3_alfie-photo-tournage.jpg)
Alfie, passe sa vie à séduire des femmes pour lesquelles il n’a aucune empathie. Jane Asher, qui est alors la compagne de Paul McCartney, interprète Annie, et la cynique Shelley Winters joue Ruby qui a un faible pour les hommes jeunes. Interpelant directement le spectateur, Alfie tient en aparté des propos choquants sur ses conquêtes et nous livre ses pathétiques états d’âme. Profondément misogyne, mais aussi lâche, menteur, manipulateur et égocentrique, c’est un affreux goujat, une personne détestable qui ne laisse derrière lui que des amitiés trahies et des destins brisés. Sous les traits de Michael Caine, il devient par moments presque sympathique, ce qui rend le film encore plus dérangeant.
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_965f37_alfie-ge-ne-rique-sonny-rollins.jpeg)
Lors d’un concert donné au Ronnie Scott en 1965, Sonny Rollins se vit approcher par le metteur en scène pour en écrire la musique. Le saxophoniste l’enregistra à Londres fin octobre avec Keith Christie (trombone) Tubby Hayes et Ronnie Scott (saxophones), Dave Goldberg (guitare) Stan Tracey (qui improvise au piano Little Malcolm Loves His Dad), Rick Laird (futur bassiste du Mahavishnu Orchestra) et Phil Seamen (batterie). Seules une douzaine de minutes de cette séance sont utilisées dans le film.
/image%2F0558410%2F20201011%2Fob_35b8ab_sonny-rollins-alfie-record-cover.jpeg)
Trois mois plus tard, le 26 janvier 1966, Sonny Rollins enregistra une version plus complète et étoffée de sa partition dans le studio de Rudy Van Gelder à Englewood Cliffs (New Jersey). Le saxophoniste en confia les arrangements à Oliver Nelson, son instrumentation nécessitant cinq saxophones, deux trombones et une section rythmique*. Bob Thiele produisit l’album sur le label Impulse, précisant qu’il ne contenait pas la bande originale du film, mais sa musique. Les titres des morceaux font tous références à des scènes. Arrangée par Oliver Nelson, ses compositions se parent de couleurs chatoyantes. On Impulse est une valse et He’s Younger Than You Are une délicieuse ballade que son chorus rend très émouvante. Le saxophoniste est au sommet de sa forme. Son jeu impétueux et expressif, sa sonorité volumineuse dynamisent Street Runner with Child. Souvent utilisé dans le film, Alfie Theme est ici proposé dans deux versions différentes. Dans la première (le plus long morceau de l’album) Kenny Burrell y prend un solo éblouissant.
/image%2F0558410%2F20201011%2Fob_7473ed_cilla-black.jpg)
La chanson Alfie qui accompagne le générique fin du film est chantée par Cilla Black. Son auteur Burt Bacharach (son complice Hal David en signa les paroles) en supervisa l’enregistrement à Londres. Il fut également l’arrangeur et le pianiste de la séance. Produit George Martin, le morceau fit un tabac en Angleterre mais un flop en Amérique. Raison pour laquelle la même chanson est interprétée par Cher dans la version américaine du film qui fut commercialisée quelques mois après sa sortie anglaise. Cher l’enregistra à Los Angeles. Produite par Sonny Bono, elle ne dépassa pas la 37ème place des hit-parades.
*Le personnel est le suivant : Sonny Rollins, Oliver Nelson et Bob Ashton (saxophone ténor), Phil Woods (saxophone alto), Danny Bank (saxophone baryton), Jimmy Cleveland et J.J. Johnson (trombones), Kenny Burrell (guitare), Roger Kellaway (piano), Walter Booker (contrebasse) et Frankie Dunlop (batterie).
“Alfie” (Bande-annonce) : www.youtube.com/watch?v=L6j-EbvSS8g
À suivre…

/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_cbfe0d_warren-beatty-mickey-one.jpg)
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_b29571_steve-mcqueen-bullitt.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201012%2Fob_e526ff_alfie-michael-caine.jpg)


/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_82b99c_the-connection-photo-plateau.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_a0e003_the-connection-shirley-clarke-affi.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_46935e_freddie-reed-the-music-from-the-conn.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_28f490_the-connection-photo-plateau-2.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_d505ee_shirley-clarke.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_b16716_howard-mcghee-the-music-from-the-con.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_d9845d_the-cool-world-affiche.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_676352_the-cool-world-photo-du-film.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_42e142_the-cool-world-de-shirley-clarke-lua.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_24ab72_the-cool-world-b-o.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_c2560c_dick-gregory-sweet-love-bitter.jpg)
/image%2F0558410%2F20201008%2Fob_797b48_sweet-love-bitter-affiche-film.jpg)
/image%2F0558410%2F20201011%2Fob_db39e3_mal-waldron-sweet-love-bitter-cove.jpeg)
/image%2F0558410%2F20201009%2Fob_30fedd_paris-blues-louis-armstrong-sidney.jpg)
/image%2F0558410%2F20201009%2Fob_9ac5bb_paris-blues-affiche.jpg)
/image%2F0558410%2F20201009%2Fob_3024a4_paris-blues-record-cover.jpg)
































































 Gate” (2011) ou “Dedicated to You” (2009). Aidé par son pianiste
Gate” (2011) ou “Dedicated to You” (2009). Aidé par son pianiste
 mesure destinées à leurs artistes.
mesure destinées à leurs artistes. D’autres paroliers et compositeurs indépendants occupèrent l’immeuble ainsi que celui du 1650 Broadway situé un peu plus loin.
Burt Bacharach et Hal David (A House is not a Home, un tube pour Dionne Warwick en 1964) et Jerry Leiber et
Mike Stoller qui entourent Elvis Presley sur la photo y emménagèrent. Ces derniers écrivirent Shoppin’ for Clothes pour les Coasters,
et co-signèrent On Broadway avec Barry Mann et Cynthia Weill, un méga hit pour les Drifters en 1963. Avant d’interpréter ses propres
chansons, Paul Simon fréquenta lui aussi le Brill Building, réalisant des démos pour d’autres artistes.
D’autres paroliers et compositeurs indépendants occupèrent l’immeuble ainsi que celui du 1650 Broadway situé un peu plus loin.
Burt Bacharach et Hal David (A House is not a Home, un tube pour Dionne Warwick en 1964) et Jerry Leiber et
Mike Stoller qui entourent Elvis Presley sur la photo y emménagèrent. Ces derniers écrivirent Shoppin’ for Clothes pour les Coasters,
et co-signèrent On Broadway avec Barry Mann et Cynthia Weill, un méga hit pour les Drifters en 1963. Avant d’interpréter ses propres
chansons, Paul Simon fréquenta lui aussi le Brill Building, réalisant des démos pour d’autres artistes.  Elling reprend son
American Tune, un des fleurons de “There Goes Rhymin’ Simon”. Nous sommes en 1973 et le Brill Building est alors déserté par ses meilleurs talents. Depuis la seconde
moitié des années 60, chanteurs et groupes composent leurs propres morceaux. Paul Simon, mais aussi Barry Mann, Neil Sedaka, Carole
King font carrière sous leur nom. L’industrie du disque n’a plus besoin de prêt-à-chanter. Une page de l’histoire de la musique populaire américaine est définitivement tournée.
Elling reprend son
American Tune, un des fleurons de “There Goes Rhymin’ Simon”. Nous sommes en 1973 et le Brill Building est alors déserté par ses meilleurs talents. Depuis la seconde
moitié des années 60, chanteurs et groupes composent leurs propres morceaux. Paul Simon, mais aussi Barry Mann, Neil Sedaka, Carole
King font carrière sous leur nom. L’industrie du disque n’a plus besoin de prêt-à-chanter. Une page de l’histoire de la musique populaire américaine est définitivement tournée. C
C Wyatt“ (Bee Jazz/Abeille Musique),
premier opus de l’Orchestre National de Jazz sous la direction artistique de Daniel Yvinec. Amateur du légendaire Soft Machine, Daniel a organisé un des trois programmes de
l’orchestre autour des compositions de son ex-batteur. Vincent Artaud a habillé ses mélodies inoubliables d’arrangements somptueux. Les voix de Yael Naïm, Arno, Camille,
Rokia Traoré, Irène Jacob,
Wyatt“ (Bee Jazz/Abeille Musique),
premier opus de l’Orchestre National de Jazz sous la direction artistique de Daniel Yvinec. Amateur du légendaire Soft Machine, Daniel a organisé un des trois programmes de
l’orchestre autour des compositions de son ex-batteur. Vincent Artaud a habillé ses mélodies inoubliables d’arrangements somptueux. Les voix de Yael Naïm, Arno, Camille,
Rokia Traoré, Irène Jacob,  (reproche que ne manquent pas de faire les détracteurs de l’orchestre), que dire
du nouveau disque de Brian Blade, “Mama Rosa“ (Verve/Universal), étonnant recueil de chansons que l’on croirait surgir de la Californie des années 70. Le batteur de Wayne Shorter
utilise des musiciens de son Fellowship Band (Jon Cowherd, Kurt Rosenwinkel, Chris Thomas), chante, joue du piano, de la guitare, de la basse et bien sûr de la batterie.
La guitare électrique de Daniel Lanois sonne comme celle de Neil Young et l’on n’écoute pas ce disque inattendu et superbe sans penser au célèbre “If I Could Only Remember My Name…“ de
David Crosby et à “No Other“ opus inoubliable de Gene Clark, deux fleurons de la pop californienne.
(reproche que ne manquent pas de faire les détracteurs de l’orchestre), que dire
du nouveau disque de Brian Blade, “Mama Rosa“ (Verve/Universal), étonnant recueil de chansons que l’on croirait surgir de la Californie des années 70. Le batteur de Wayne Shorter
utilise des musiciens de son Fellowship Band (Jon Cowherd, Kurt Rosenwinkel, Chris Thomas), chante, joue du piano, de la guitare, de la basse et bien sûr de la batterie.
La guitare électrique de Daniel Lanois sonne comme celle de Neil Young et l’on n’écoute pas ce disque inattendu et superbe sans penser au célèbre “If I Could Only Remember My Name…“ de
David Crosby et à “No Other“ opus inoubliable de Gene Clark, deux fleurons de la pop californienne. L
L “
“ dans un programme consacré à Boris Vian.
dans un programme consacré à Boris Vian.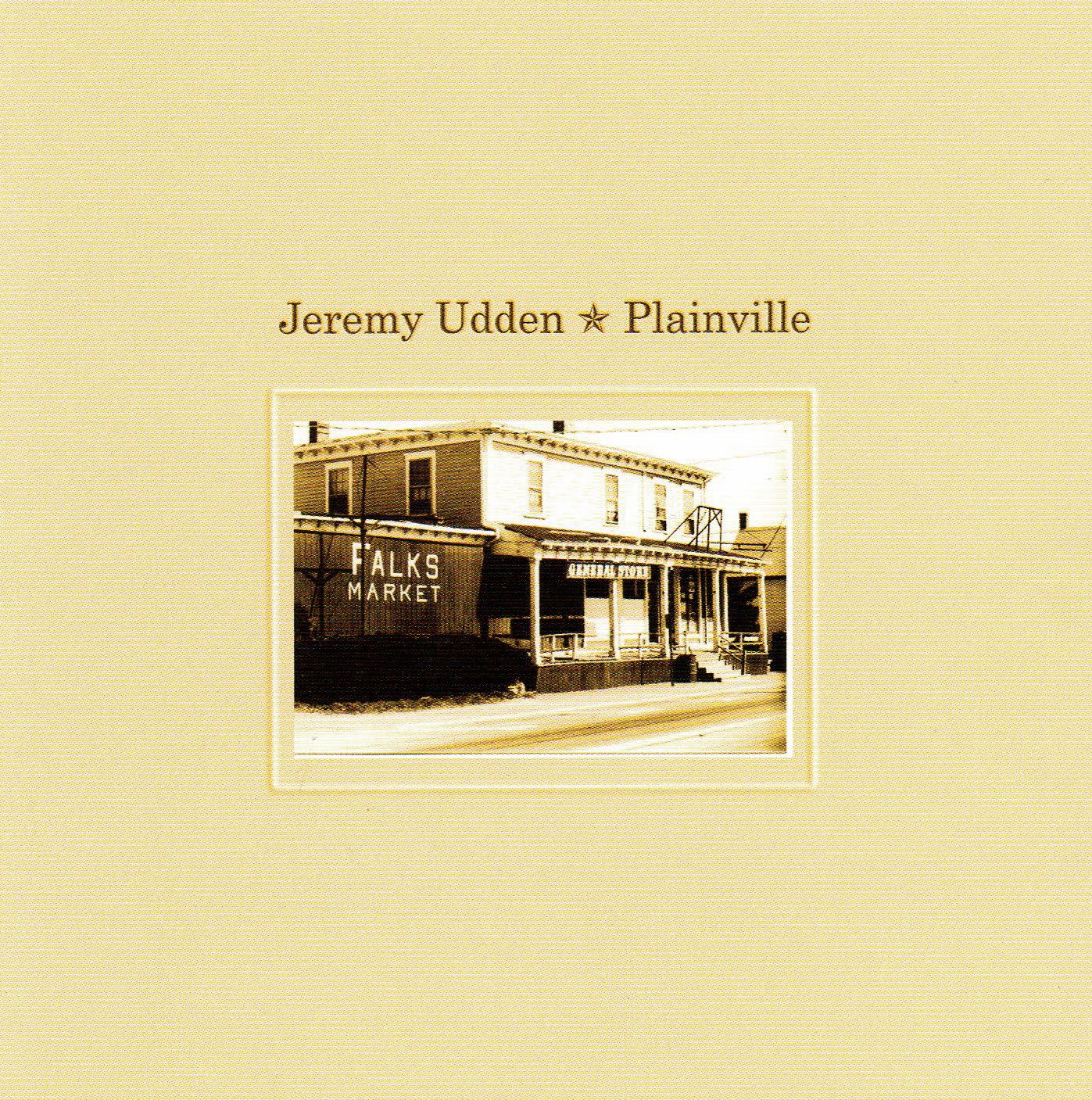 “
“ musiques qui bercèrent son adolescence et nous livre un superbe
livre d’images sonores sur la grande Amérique.
musiques qui bercèrent son adolescence et nous livre un superbe
livre d’images sonores sur la grande Amérique.